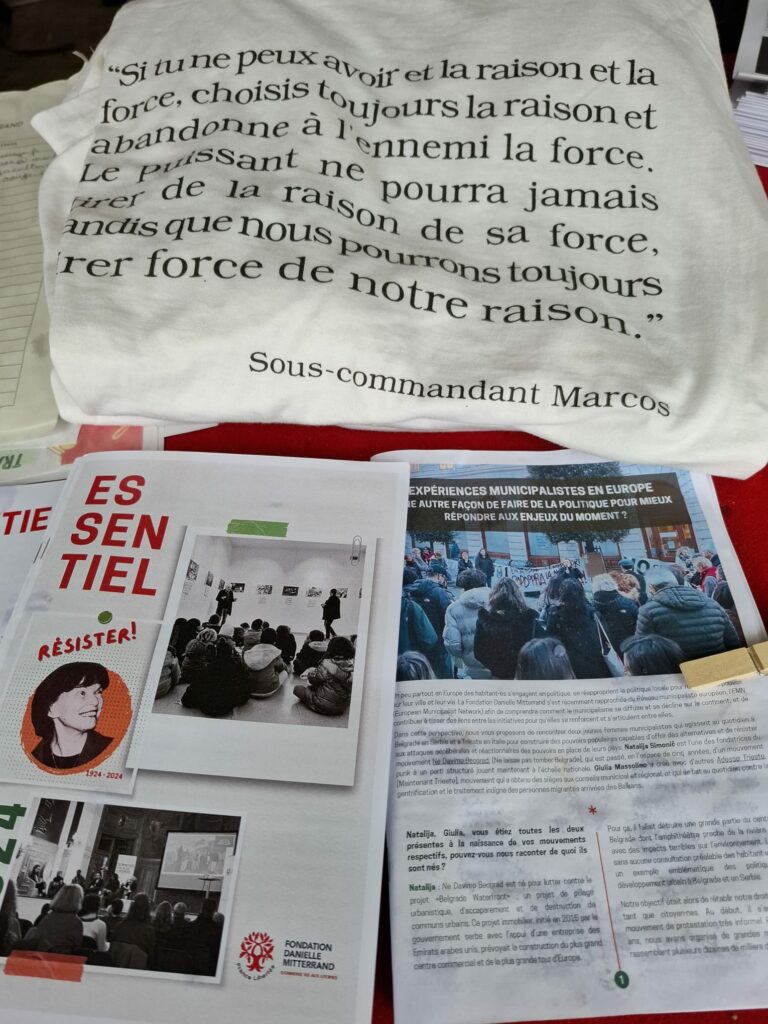La Fête de l’Humanité 2025
01.10.2025
Pour sa 90e édition, la Fête de l’Humanité a connu un record de participation avec pas moins de 610 000 personnes réunies pour ce rendez-vous festif et politique majeur ! Cette année encore la Fondation était présente durant ces 3 jours avec une riche programmation autour des enjeux écologiques, sociaux et politiques actuels..
« Agiter les idées » – Un espace vivant de débats et de rencontres
Sous la bannière « Agiter les idées », notre espace de débats n’a (presque) jamais désempli. Cartes blanches, tables rondes et discussions animées ont rythmé ces trois jours, donnant la parole à celles et ceux qui, sur le terrain, luttent, inventent et transforment.
Jour 1 – Résister à l’injustice : luttes populaires et syndicales face à la violence structurelle
La journée s’est ouverte avec Human Conet, autour des luttes paysannes et autochtones en Colombie.
Face à l’extractivisme, à la violence politique et à la privatisation des ressources, ces communautés se battent pour leur survie. À travers leurs récits, c’est une résistance ancrée qui s’exprime : celle de communautés qui refusent de céder leur terre, leur eau, leur culture. Ce sont aussi des expériences concrètes d’autonomie territoriale et de défense collective qui ont été partagées.
La journée s’est poursuivie avec une carte blanche intitulée « Mémoire vivante des Gilets Jaunes, 10 septembre, et après ? », en écho aux mobilisations sociales de l’automne. Mil-an, du collectif Le Rond Point, et Benjamin, de Changer de Cap, ont croisé leurs parcours dans le mouvement des Gilets Jaunes. Au-delà de la révolte sociale, c’est un élan démocratique silencieux qui s’est joué : les ronds-points comme lieux de politisation, la rue comme espace de rencontres et d’apprentissage commun. Leur échange a permis de tirer certaines leçons de cette séquence, tout en interrogeant les formes futures d’organisation, à l’aube des nouvelles mobilisations de l’automne 2025.
Pour se terminer avec la table-ronde « Régularisation, travail et luttes syndicales : quels enjeux pour demain ? » avec des membres de la CGT transports, la filière déchets et l’association A4. Les témoignages partagés ont dressé un tableau accablant : exploitation, précarité permanente, racisme systémique… la réalité à laquelle sont confronté·es les travailleur·ses sans papier est d’une grande violence. Face à ces abus, les résistances s’organisent avec et au sein de lutte syndicale pour défendre le droit à la dignité et à la régularisation des personnes. Une idée forte a traversé les échanges : le syndicalisme doit changer s’il veut être un outil d’émancipation pour toutes et tous, en ville comme à la campagne.
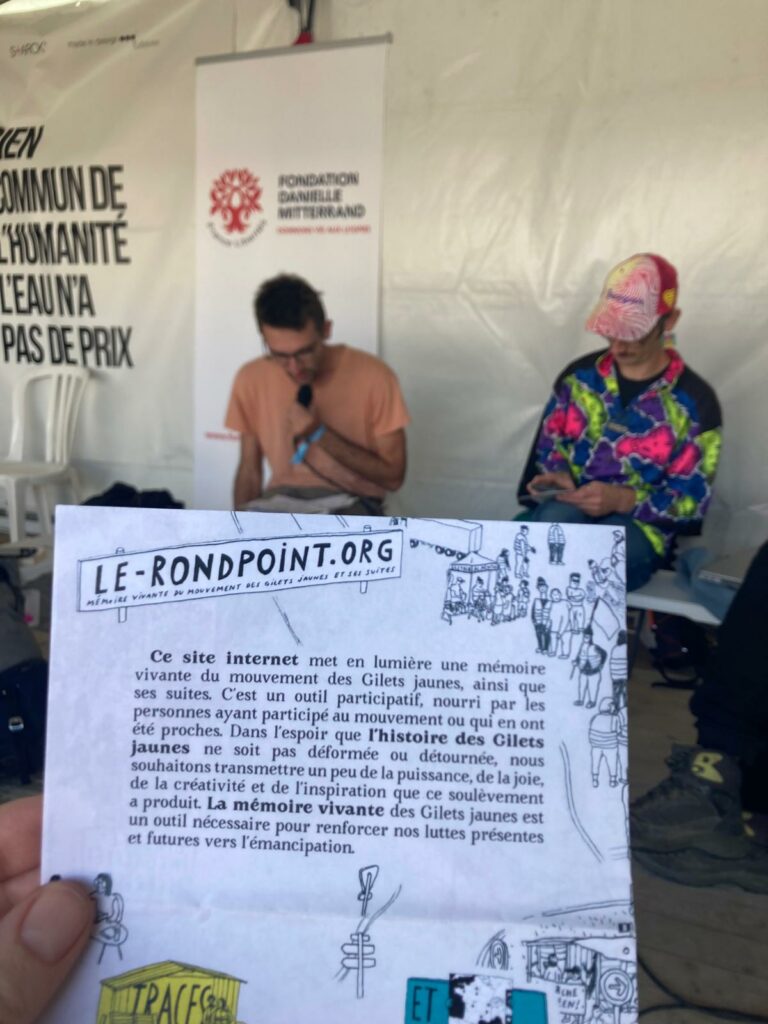

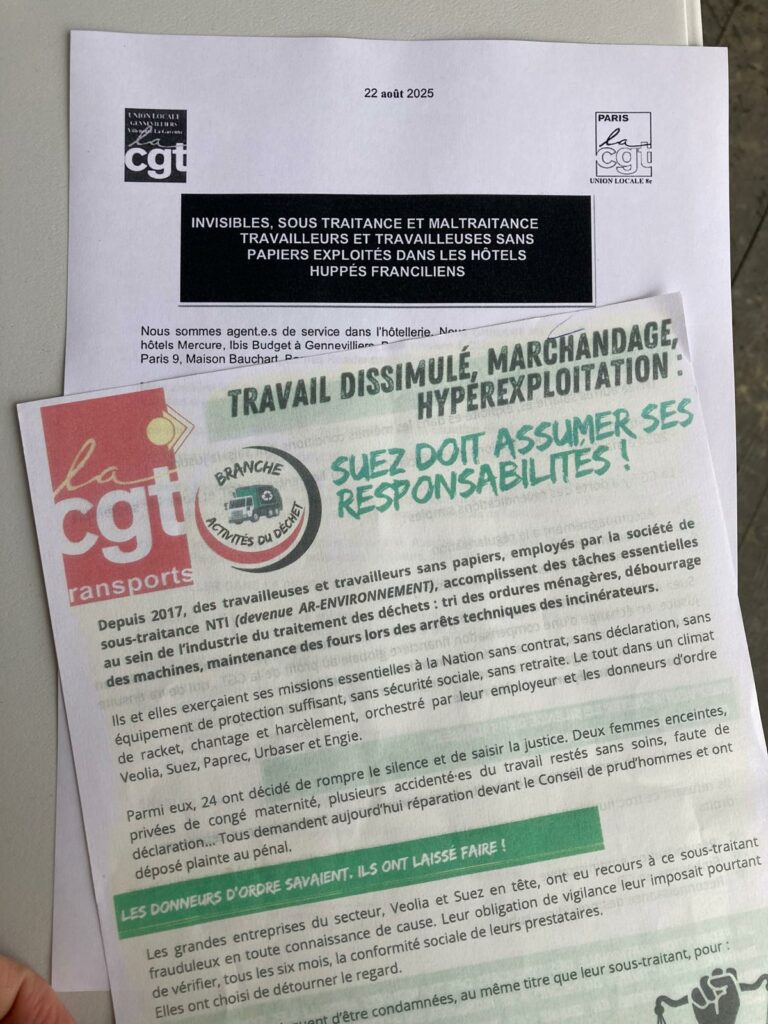
Jour 2 – Reprendre le pouvoir localement : parité sociale, municipales et histoire des luttes des quartiers populaires
La table ronde « Comment faire des municipales 2026 un catalyseur de pouvoirs habitants ? » a réuni Salah Amokrane (Assemblée des quartiers et Les Motivé·es de Toulouse), Camille Dantec (du réseau Actions Communes) et Annie Lahmer (Démocratiser la politique). Ensemble, ils et elles ont partagé leur vision sur le potentiel stratégique des élections municipales face à l’urgence démocratique. Face à la montée de l’extrême droite, aux désillusions vis-à-vis de la gauche institutionnelle, l’engagement local et au sein des communes peut faire advenir des lieux de résistance, des espaces d’expérimentations démocratiques par et pour les habitant·es, mais aussi des lieux de refuge.
Lors de la carte blanche de Démocratiser la politique, plusieurs membres du collectif ont présenté leur rapport « Tous les mêmes », issu d’une recherche-action sur la parité sociale en politique. Et le constat est sans appel : les classes dominantes continuent de confisquer le pouvoir politique tandis que les classes populaires sont massivement évincées des espaces institutionnels. Le collectif s’est alors penché sur des pistes concrètes pour remédier à cette situation : « quotas » dans les partis, déconstruire le mépris de classe dans les institutions, rendre accessible la formation politique, etc. Transformer la politique, c’est aussi changer qui y accède, et la remettre entre les mains de celles et ceux qui en sont jusqu’alors exclu-es.
Dans la foulée, la carte blanche de l’Assemblée des Quartiers a donné à voir une autre histoire politique : celle qui prend vie depuis des années dans les quartiers populaires, dans les luttes de l’immigration et celles de l’antiracisme politique. Transmettre cette mémoire, c’est non seulement partager une histoire pour nourrir les expériences présentes, mais aussi briser l’ignorance d’une partie des milieux de gauche vis à vis de ces expériences inspirantes ! Des échanges ont suivi autour du projet Education4Gaza, qui promeut une éducation digne pour les enfants dans les camps de réfugié·es en Palestine, et avec les jeunes de G.A.V Média, qui ont partagé leurs quotidiens, marqués par les inégalités mais aussi leurs engagements pour construire un avenir plus juste. Un message clair : les quartiers populaires ne manquent ni d’idées ni d’énergie bien au contraire, ils regorgent d’initiatives !





Jour 3 – Résistances internationales et alliances stratégiques
La dernière journée s’est ouverte avec un moment fort : la venue de femmes du Nord-Est syrien, pour échanger autour de l’actualité au Kurdistan et des résistances populaires au Moyen Orient. A leurs côtés Fatemeh Karimi (militante kurde d’Iran et membre du collectif Roja) et Berivan Firat (porte-parole du CDK-F). Au cours des échanges nous avons ainsi pu en apprendre davantage sur les réalités politique en Turquie suite à l’appel pour la paix lancé par Ocalan, en Syrie après la chute du régime sanguinaire d’Assad et l’arrivée au pouvoir d’Al-Charaa et enfin en Iran, 3 ans après l’assassinat de Jina Masha Amini, et la révolte populaire qui a suivi. D’un territoire à l’autre, la résistance se poursuit malgré l’adversité !
Dernier échange, mais pas des moindres « Construire l’alliance des quartiers populaires et des ruralités : coup de comm’ ou perspectives réelle ? ». Autour de la table : Youcef Braki (de l’Assemblée des quartiers de Bagnolet et du comité Adama), Aissata Anne (de l’Assemblée des quartier Mantes-la-Jolie), Manon Rousselot Pailley (MRJC), Dieynaba Sy (de Démocratiser la politique). Ils et elles sont revenu·es sur un débat récurrent : peut-on réellement construire ces alliances ? Et le constat est sans détour : l’alliance est aujourd’hui plus un slogan qu’une réalité. Les enjeux spécifiques – discriminations racistes, accès aux services publics, précarité, relégation – se vivent différemment selon les territoires. A cela viennent s’ajouter des enjeux de classes sociales qui complexifie les réalités territoriales. Le manque d’espaces de rencontres, l’importance de l’antiracisme, l’accumulation de priorités et d’autres actions concrètes à mettre en œuvre, sont autant de freins à ces alliances. Un débat lucide, nécessaire, qui rappelle que la convergence ne se décrète pas : elle se construit, patiemment…


« Mise en lumière » – Un espace de découverte et d’informations
Trois jours. Des dizaines d’intervenant·es. Des centaines de personnes venues échanger, écouter, débattre.
Des luttes locales aux combats internationaux, des anciennes voix aux jeunes générations, la Fondation Danielle Mitterrand a affirmé son rôle : accompagner les luttes, créer des ponts, participer à construire des futurs émancipateurs.
Nous repartons avec de nouvelles idées, de nouveaux liens, de nouvelles espérances. Mais surtout, une conviction renforcée : rien ne se fera sans les alliances concrètes entre celles et ceux qui luttent, ici et ailleurs.