
Barine Amaidet, réfugiée kurde : « je n’ai toujours pas terminé mon combat »
14.01.2019
Barine Amaidet a accepté de nous rencontrer à l’occasion de la sortie de son livre Au pays des fleurs. Un récit simple et direct qui retrace l’histoire de sa famille entre le Kurdistan irakien, la Turquie et la France.
France Libertés : Vous avez fui les bombardements de Saddam Hussein contre les Kurdes et vécu dans un camp de réfugiés en Turquie avant de partir pour la France grâce à l’action de Danielle Mitterrand. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire ?
Barine Amaidet : J’ai essayé de parler de beaucoup de thèmes en même temps, parce que tous ces thèmes-là, je les ai vécus et en famille. A un moment donné il fallait passer par l’écriture, faire en sorte de matérialiser ce passé puis de m’en défaire aussi. Je me disais « moi je n’ai toujours pas terminé mon combat, je n’ai pas fini ».

D’où vient le titre de votre livre « Au pays des fleurs » ?
C’est le titre sur lequel je m’étais arrêtée avant même de proposer le manuscrit à l’éditeur. Il y a deux raisons. La première c’est que mes parents, quand je suis née, m’avaient appelé Gullistane, ce qui veut dire « au pays des fleurs » en kurde. Mais il y avait eu beaucoup de naissances autour d’eux, beaucoup de filles avaient le même prénom, mes parents ont donc changé d’avis et m’ont appelé Barine.
La seconde raison vient d’une frustration dans le camp en Turquie. Des soldats nous surveillaient pour que l’on ne puisse pas sortir. Derrière eux, on voyait des champs de coquelicots et d’un mélange de fleurs. Avec ma sœur, on se disait que ce serait trop bien d’aller jouer là-bas. Notre rêve à toutes les deux, c’était d’aller cueillir des fleurs. Un jour on l’a fait, mais malheureusement, comme je le raconte dans le livre, ma sœur s’est pris un coup de fusil dans le dos qui lui a créé un gros souci qu’elle a gardé jusqu’à maintenant, une scoliose. C’est cet interdit, la frustration de ne pas pouvoir aller dans ce « pays des fleurs », d’être enfermé dans un camp… cela allait de soi, le livre ne pouvait pas s’appeler autrement.
Vous écrivez dans ce récit « l’amitié franco-kurde qui me tient à cœur s’est incarnée tout d’abord en une personne : Danielle Mitterrand. C’est la première française qui a fait partie de ma vie et que je n’oublierai jamais. Sans son action à travers son association, serions-nous encore vivants ? ». Quel a été le rôle de Danielle Mitterrand ?
Danielle Mitterrand était déjà venue chercher plusieurs groupes dans ce camp de réfugiés. Sa dernière mission a été la nôtre. D’après ce que je sais, elle choisissait les grandes familles, car elle avait eu droit à un certain nombre de familles et non pas de personnes, ce que je garderai toujours en tête. On a été appelé au haut-parleur dans le camp, pour nous dire qu’on partait. On n’avait pas grand-chose à prendre. Les stocks de vêtements, on les a laissés à ceux qui sont restés. On a donné nos couvertures, la tente, nos réservoirs pour l’eau, nos ustensiles, on est partis avec presque rien.
J’ai une photo de moi avec Danielle Mitterrand, car je l’ai rencontré à plusieurs reprises. Elle est venue en 1998 pour rencontrer les personnes arrivées en France en 1988, pour les 10 ans de leur arrivée. On a fait une fête en Auvergne. On avait pris une salle avec l’association kurde de l’époque. Elle avait envie de manger kurde, chaque famille a préparé un plat différent. Ma mère et les autres femmes kurdes se sont entendues pour qu’il y ait un peu de tout. On l’a accueilli avec de la musique, on s’est habillé en tenue traditionnelle kurde. Puis il y a eu la fête à Albi, en 2001 il me semble. Danielle Mitterrand s’est rappelée de moi, elle m’a reconnu. C’est là qu’on a pris une photo ensemble. J’espère qu’à travers le livre, j’ai pu mettre en avant tout ce que Danielle Mitterrand a fait et la remercier à ma manière.

L’un de vos chapitres s’intitule « la résilience ou comment continuer à vivre après un traumatisme ». D’où vient cette capacité à se reconstruire ?
Il faut avoir un entourage très fort et surtout permettre beaucoup de communication, ne pas laisser des paroles en l’air. Il ne faut pas se relâcher. Je me suis dit, j’ai de la chance, j’ai la chance de me reconstruire physiquement, j’ai la chance d’être bien entourée. Il faut que je me donne les moyens de réussir et de montrer aux quelques personnes négatives que j’ai rencontrées qu’elles se sont trompées, et pour montrer aux autres qu’une personne réfugiée peut gravir les échelons et s’en sortir au même titre que quelqu’un d’autre. On n’est pas plus bêtes que d’autres personnes. Je me suis toujours donné des objectifs et j’ai toujours tout fait pour les atteindre. Pour ma reconstruction physique, j’ai pris mes rendez-vous chez les médecins toute seule, pourtant j’étais petite à l’époque. Pour ma première opération chirurgicale, j’étais en cinquième et j’y suis allée toute seule. Je me suis dit « si je ne m’occupe pas de moi, comment je veux que les autres s’occupent de moi ».
C’est dur au début, on sait que ça va être très long, une reconstruction, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On met beaucoup de temps. Moi je ne me suis pas appuyée ma famille pour me reconstruire car je pense que le fait qu’on ait tous vécu ce traumatisme fait qu’on a du mal à percevoir que les autres souffrent. J’ai trouvé refuge à l’école, au niveau des professeurs j’ai toujours été bien accompagnée. Ils m’ont poussé à faire de mon mieux, à avancer. Ils ont toujours vu des bonnes capacités en moi, ça m’a bien aidé au niveau scolaire.
Vous parlez de votre intégration réussie en France, et au-delà du témoignage, vous faites passer en filigrane un message sur les réfugiés
Ce qu’on entend dire sur les réfugiés, ça me fait mal. Je me dis vraiment que la plupart des gens qui regardent les informations ont une image négative des réfugiés, alors ce sont eux qui font le plus gros du travail, ce sont eux qui arrivent avec des traumatismes, eux qui ont tout quitté et qui doivent tout reconstruire.
Il va y avoir des plaies jamais pansées du fait de ce mauvais accueil. On va créer d’autres conflits avec l’immigration aujourd’hui. Dans 20 ou 30 ans, les jeunes se rappelleront, se diront « on a été très mal accueillis, on s’est mal occupé de nous, on nous a traité comme des moins que rien ». Il y aura une certaine amertume, que je n’aurai jamais justement, ce qui fait qu’aujourd’hui je me sens bien, en accord avec les deux cultures. Peu importe le mélange de cultures entre la France et un autre pays, pour moi, le mélange est possible, complémentaire dans tous les cas. Malheureusement, je me dis que pour ceux qui sont arrivés maintenant, avec ce sentiment de rejet, la construction ou la reconstruction va être difficile. Il ne faut pas oublier que lorsque les réfugiés arrivent, psychologiquement, ils ne vont pas bien, ils ont tout quitté, ils ont vécu des traumatismes difficiles.
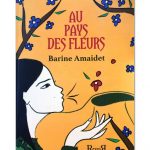 Vous pouvez commander le livre de Barine Amaidet sur le site internet des éditions Revoir.
Vous pouvez commander le livre de Barine Amaidet sur le site internet des éditions Revoir.
- Avril 2018
- Prix: 16€
